
Henry-
Très attaché à l’Auvergne et au Cantal, en particulier où il a passé toute sa vie, il profite de sa retraite pour se consacrer à ses passions : la généalogie et l’histoire locale.
Ces recherches nourrissent son écriture dont la constance est la défense de la condition féminine.
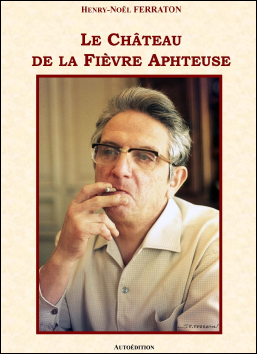
Jean Ferraton a vécu quarante ans à Saint-
Au travers de l’histoire de Jean FERRATON, de sa famille, de ses employés et de quelques familles amies, c’est la vie de Saint-
L’auteur a interrogé de nombreuses personnes qui ont connu Chantal et Jean Ferraton. Il a consulté les publications et journaux sanflorains de cette période. De nombreuses anecdotes émaillent ce récit qui se veut avant tout comme le témoignage d’une vie et d’une passion.
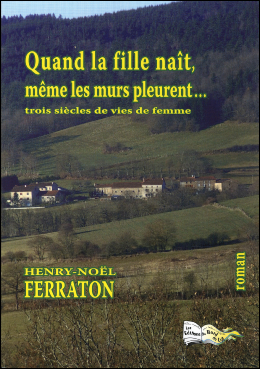
Dans une famille paysanne auvergnate, au XVIIIe siècle, la naissance d'une fille n'est pas un événement heureux. Le garçon reprendra l'exploitation et gardera le patronyme familial. On devra trouver un mari et surtout doter la fille.
À Soubrevèze, près de Saint-
La Révolution Française puis le XXe siècle verront les femmes Vallot participer aux petits et grands combats des féministes.
La Guerre de 14-
Toutes, à l’image de Marguerite, la révolutionnaire, et de Marie-
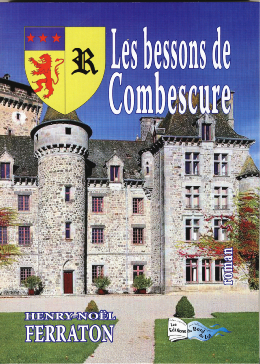
Les secrets de famille sont très souvent douloureux à porter. Ils influent sur les comportements et les caractères. Gérard Duhaut, quatrième enfant mal aimé d’une famille de Paysans de la Margeride, se voit souvent comparé à Léon, un aïeul condamné au bagne dont personne ne veut parler. Parti travailler à Paris, il se découvre un sosie parfait : Jean-
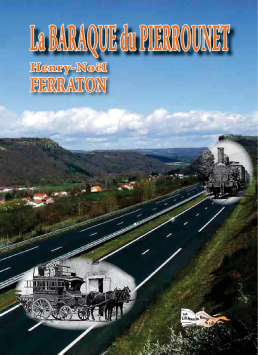
Les secrets de famille sont très souvent douloureux à porter. Ils influent sur les comportements et les caractères. Gérard Duhaut, quatrième enfant mal aimé d’une famille de Paysans de la Margeride, se voit souvent comparé à Léon, un aïeul condamné au bagne dont personne ne veut parler. Parti travailler à Paris, il se découvre un sosie parfait : Jean-
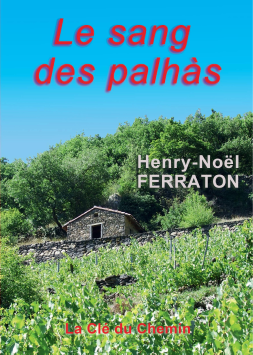
Sur les pentes abruptes des versants Sud de la vallée de l’Alagnon, les hommes depuis des siècles ont construit des murets de pierres sèches pour retenir la terre et cultiver la vigne. A Molompize, Antoine Berligier est l’un des derniers paysans à produire du vin sur ces terrasses que l’on appelle les palhàs. A l’aube du XXe siècle, sa famille, après avoir vaincu l’oïdium, est venue à bout du terrible phylloxera. Malgré les épreuves, la Grande-
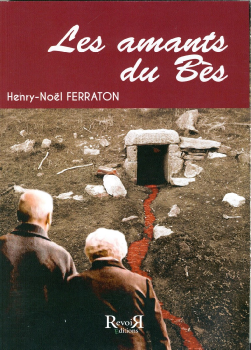
Joseph et Adeline sont les jeunes enfants de paysans cantaliens. Seuls les aînés auront des droits sur la propriété familiale. Ce n’est pas leur cas. Arrivés à l’âge adulte, ils décident de se marier malgré l’opposition de leurs parents. Sans terre et avec peu d’argent, ils savent que leur existence sera difficile. À force de travail, Joseph parvient à se créer une situation confortable. Tout irait pour le mieux, mais après de nombreuses années, le couple n’a toujours pas d’enfant. Joseph a découvert son incapacité d’être père, mais s’est bien gardé d’en parler. Adeline n’admet pas la stérilité de Joseph. Elle estime que seules les femmes sont responsables de leur maternité. Soutenue dans cette idée par sa mère, sa famille, elle se détruit lentement, tandis que Joseph profite de son handicap pour la tromper et disparaître totalement. Malgré les épreuves terribles, les situations difficiles, ses sentiments pour Joseph restent intacts. Elle ne désespère pas de le retrouver.
Trente ans plus tard, va-
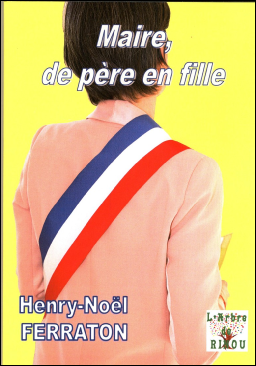
Derrière la haine séculaire que se portent deux familles rivales et la disparition du curé du village au moment de la loi de séparation des églises et l’état, deux femmes alliées aux clans adverses vont tenter de ramener le calme dans cette localité dont l’une va devenir le maire.
A Saint-
Philippe Chaubert le maire sortant attribue sa défaite aux recherches engagées par les deux institutrices du bourg sur la disparition du prêtre et du trésor de la paroisse qui ont exacerbé l’hostilité qui anime les deux tribus. Leurs découvertes vont rouvrir les plaies tout juste refermées des joutes qui ont opposé les deux clans rivaux.
Cette histoire totalement imaginée, mais tellement proche de la réalité se veut un hommage à toutes ces femmes qui, de plus en plus nombreuses, exercent les fonctions de maire.
Pas facile d’être femme et maire !
Des rencontres avec des femmes maires m’ont permis de comprendre cette alchimie délicate que seule une femme peut réussir.
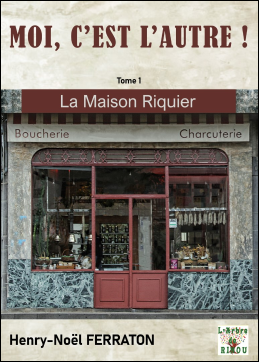
La Maison Riquier est une boucherie familiale transmise de père en fils depuis plusieurs générations. Maurice, l'actuel boucher et sa femme la Bernarde ont déjà trois filles quand survient une nouvelle naissance. Ils espéraient un fils, ils auront des jumeaux : un fils pour leur plus grande joie, mais aussi une fille qui sera prénommée Claude. Elle sera l'Autre pour sa mère qui lui refuse toute affection, toute tendresse pour se consacrer à Bruno, ce fils tant désiré. « Je suis en permanence sous la dépendance d'une mère tyrannique dont j'ai fini par comprendre que non seulement, elle ne m'aimait pas, mais qu'elle n'a jamais accepté ma naissance. Déjà mère de trois filles, alors qu'elle appelle de tous ses vœux un héritier mâle, voilà que j'arrive jumelle avec un garçon. Je suis l'enfant de trop, celui dont elle aurait souhaité se débarrasser pour consacrer tout son amour à son fils. »
Claude raconte sa vie d'enfant rejetée, mais surtout son incapacité à aimer, son manque de confiance en elle, dus au dénigrement, aux souffrances que lui font subir ses parents et en particulier sa mère. « Terrible ostracisme que votre fille n'a jamais pu comprendre, elle n'a pas demandé à venir au monde, elle n'a pas choisi d'être une fille et, dès sa naissance, vous le lui avez reproché. Pire, vous avez ouvertement privilégié Bruno en créant entre les jumeaux une différence d'éducation qui a engendré ce mal-
Saura-
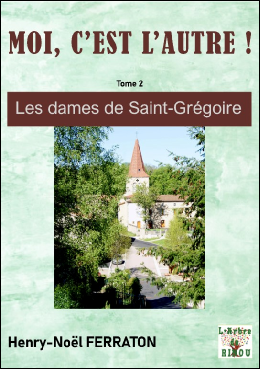
Claude sort d’une terrible épreuve dont elle aura du mal à se remettre. Son retour à une vie normale risque d’être compliqué après plus de onze années passées en prison pour un meurtre qu’elle n’a pas commis. D’autant que, rejetée par sa famille au profit de son frère jumeau, elle n’a pas bénéficié de conditions idéales pour s’épanouir en tant qu’enfant puis femme adulte. Saura-
Trouvera-
Après l’écriture du premier tome composé au féminin, l’auteur a pris un plaisir non dissimulé à rédiger la suite de Moi, c’est l’Autre ! Se placer dans un esprit du sexe opposé quand on est un homme est un exercice délicat qui demande naturellement une relecture, mais c’est une démarche extrêmement enrichissante qui l’aura marqué. Ces deux tomes s’inscrivent dans la logique de ses précédents romans dans lesquels l’auteur met en avant des femmes dans leurs défis face à la gent masculine.
Site personnel: http://rinou.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009194402109
Instagram: https://www.instagram.com/hnferraton/
Adresse courriel: contact@rinou.fr
Téléphone: 06.70.75.16.09
©2024 -